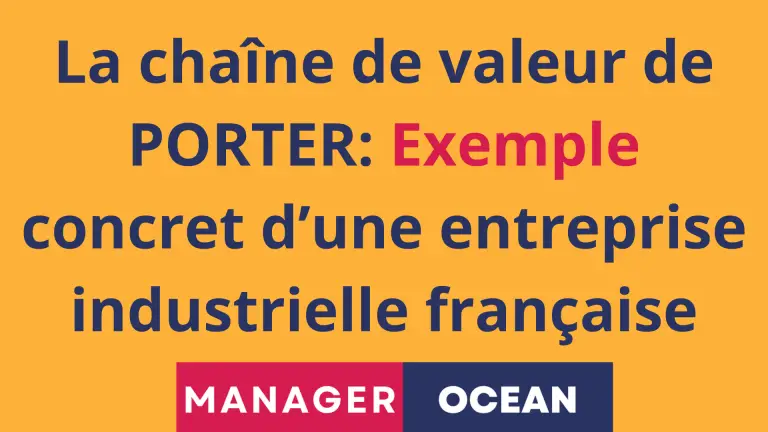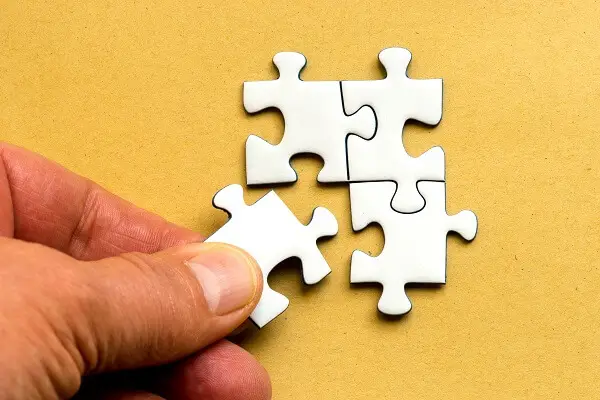Le consortium d’exportation: définition, avantages, typologie et exemples concrets

À quoi sert un consortium d’exportation?
La réponse évidente réside dans le fait que la majorité des PME (petite et moyenne entreprises) sont souvent isolées et se heurtent à de nombreuses difficultés pour accéder aux marchés étrangers.
Ce constat est justifié par l’insuffisance des ressources, compétences et connaissances nécessaires à l’exportation chez les PME. Aussi, leur incapacité de satisfaire les exigences imposées par les réglementations étrangères. Enfin, nous pouvons citer le manque d’attractivité des produits proposés pour les consommateurs étrangers.
Les alliances stratégiques, traduites par la création des consortiums d’exportation, peuvent être une solution efficace pour les PME désirant pénétrer les marchés étrangers.
Cette option stratégique consiste, pour ces PME, à mettre en commun leurs ressources et leurs compétences et peut leur permettre d’améliorer leurs performances et réduire les coûts et les risques inhérents à l’internationalisation.
Dans cet article, nous allons essayer tout d’abord de définir les consortiums d’exportation, analyser les motivations de formation de ces structures, présenter leurs avantages, leurs typologies ainsi que la situation actuelle des consortiums aux niveaux international.
1.Les spécificités du consortium d’exportation
1.1. définition d’un consortium d’exportation
Un consortium d’exportation peut être défini comme « l’alliance volontaire d’entreprises, souvent des PME, dont l’objectif est de promouvoir les biens et les services de leurs membres à l’étranger et de faciliter l’exportation de ces produits grâce à des actions communes».
Un consortium d’exportation peut être envisagé comme une coopération stratégique formelle, à moyen ou à long terme, entre des entreprises; celui-ci agit comme un fournisseur de services dont la spécialité est de faciliter l’accès aux marchés étrangers(Federexport,1998).
De ces deux définitions, nous pouvons constater que le consortium d’exportation permet aux PME associées de promouvoir leurs produits et services à l’étranger tout en gardant leur indépendance juridique, financière et organisationnelle.
C’est aussi une forme de coopération stratégique entre des PME concurrentes sur le marché local, ce qui leur permet de maintenir leur identité.
Nous pouvons rencontrer les consortiums d’exportation dans les différents secteurs d’activité notamment, le textile, l’habillement, l’agroalimentaire, l’artisanat et la bijouterie.
1.2.Les motivations de formation d’un consortium d’exportation
Certes, la commercialisation d’un produit ou un service sur un marché extérieur est plus difficile que sur un marché local. C’est la raison qui a poussé un certain nombre de PME à renoncer définitivement à l’exportation.
Il faut noter aussi que certaines PME ont vu leurs tentatives à l’exportation vouées à l’échec à cause d’un mauvais diagnostic à l’export et de l’absence d’une bonne préparation. L’exportation nécessite des savoir-faire importants et des ressources et compétences considérables.
La littérature présente une panoplie de raisons qui poussent les PME à adhérer à un consortium d’exportation. Nous pouvons résumer ces motivations dans les points suivants :
- insuffisance des ressources financières, humaines, logistiques et organisationnelles des PME par rapport aux conditions et exigences de l’exportation ;
- la majorité des PME sont des entreprises monoproduits, c’est-à-dire qu’elles sont spécialisées dans la production d’un seul produit. Or, les distributeurs ainsi que les consommateurs étrangers sont très exigeants sur la nécessité de proposer un large choix de produits et services. Vu les moyens des PME, il paraît difficile d’élargir la gamme des produits de ces dernières ;
- les centrales d’achat et les autres intervenants dans les circuits de distribution à l’étranger exigent des quantités de production importantes pour pouvoir satisfaire les consommateurs étrangers. Cependant, les PME ont des capacités de production souvent limitées ;
- les PME ne détiennent pas les connaissances nécessaires à l’exportation. Or, ces connaissances ne sont pas offertes gratuitement, au contraire, elles exigent un budget considérable et une structure bien adaptée à l’exportation ;
- les clauses de la réglementation internationale et des normes et standards techniques et environnementaux deviennent de plus en plus difficiles à satisfaire ;
- le caractère familial des PME.
1.3.Les avantages d’un consortium d’exportation:
En combinant leurs moyens et ressources dans le cadre d’un consortium d’exportation, les PME adhérentes peuvent pallier les obstacles liés à l’exportation cités ci-dessus. Ainsi, les consortiums peuvent procurer aux PME les avantages suivants :
- Accroitre l’efficience: la participation à un consortium d’exportation permet aux PME adhérentes de partager les différents coûts entre elles, notamment les coûts de l’administration, de promotion et de commercialisation des produits sur les marchés étrangers ainsi que les différents frais liés à la logistique de l’exportation. Par conséquent, ce partage aboutit à une économie d’échelle et une réduction des charges des entreprises membres du consortium ;
- Améliorer l’efficacité commerciale et logistique : la coopération interentreprises entre les PME dans le cadre d’un consortium d’exportation permet à ces entités de prospecter les nouveaux marchés étrangers à travers des actions de conquête communes (participation aux salons et foires) et par voie de conséquence, contribuer à l’amélioration de leur chiffre d’affaires à l’export, leurs parts de marché et la satisfaction des clients. En bref, ces structures permettent aux PME d’améliorer leurs résultats commerciaux et financiers d’une façon globale;
- Apprentissage organisationnel des PME : cet avantage est considéré l’un des plus importants d’un consortium d’exportation. En effet, en participant à un consortium d’exportation, les membres peuvent améliorer leurs connaissances sur la façon d’opérer sur un marché étranger, améliorer la gestion de leurs opérations dans des domaines qui ne sont pas liés à l’exportation et participer à une alliance (Renart, 1999). Les consortiums permettent aux PME adhérentes d’échanger les connaissances et les expériences dans plusieurs domaines comme les techniques logistiques à l’exportation, les techniques de paiement et de financement à l’international ou encore les études de marché à l’international.
- Réduction des risques : les consortiums d’exportation peuvent contribuer à la réduction des risques inhérents à l’exportation par le biais de la diversification des produits présentés à l’export et le ciblage de plusieurs marchés étrangers. La diversification produit va engendrer une satisfaction accrue des intermédiaires et des consommateurs et par conséquent le risque de perte des clients se verra diminuer. Aussi, la diversification marché va provoquer une chute de dépendance de la PME vis- à- vis d’un marché étranger.
- Avantage concurrentiel : la mise en commun des ressources des PME dans un consortium permet à ce dernier d’avoir un effet de taille importante aux yeux des distributeurs, des clients et des fournisseurs. Ceci dit, le pouvoir de négociation du consortium avec ses partenaires se verra augmenter de façon considérable.
En résumé, les consortiums d’exportation peuvent contribuer à l’amélioration de la performance globale des PME adhérentes par l’augmentation de leurs résultats commerciaux et financiers, la réduction de leurs différents coûts et les divers risques liés à l’export et l’amélioration de leur pouvoir de négociation avec leurs partenaires.
1.4.Typologie des consortiums d’exportation:
Les services offerts aux PME participantes diffèrent d’un consortium à un autre. Les deux principaux types de consortiums pouvant être distingués sont les consortiums de promotion et les consortiums de vente[1].
- Consortium de promotion : comme son nom l’indique, l’objectif de ce type de consortium est de promouvoir les produits des PME adhérentes sur les nouveaux marchés étrangers inexplorés par les PME avant l’adhésion au consortium, et ce, en partageant les coûts de promotion et de logistique. Donc, la mission principale de cette structure est d’aider les PME à accéder aux marchés étrangers difficiles à explorer à titre individuel. Le nombre de PME adhérentes à ce type de consortium est généralement significatif. Une fois les marchés cibles sont explorés, les PME adhérentes commercialisent d’une façon autonome leurs produits.
- Consortium de vente : ce type de consortium vise principalement la vente et l’acheminement des produits des PME membres vers les marchés étrangers. Les consortiums de vente réalisent les activités de promotion et organisent la vente des produits des entreprises membres[1] et le nombre d’entreprises membres est habituellement limité dans ce type de consortium.
Dans un souci d’harmonisation des actions et des efforts commerciaux déployés par le consortium, les entreprises membres délèguent l’autorité d’agir en leur nom aux managers du consortium.
Il existe deux types de consortiums de vente : les consortiums d’échange et les consortiums agissant en agents d’exportation.
Le premier mode procède à l’achat des produits des PME membres pour tenter de les revendre sur les marchés étrangers. Le consortium se charge de la négociation commerciale et du recouvrement des créances et le paiement des entreprises membres pour leurs produits.
Dans le second, les entreprises membres envoient leurs propres factures et essaient d’obtenir le paiement de leurs clients (Renart, 1997).
Nous avons rencontré également dans la littérature d’autres types de consortium d’exportation à savoir, les consortiums à secteur unique et consortiums à secteurs multiples, les consortiums entre concurrents et non concurrents, les consortiums régionaux et ceux rassemblant des membres de plusieurs régions et les consortiums visant une région spécifique et ceux actifs sur une échelle globale.
Enfin, certains experts ont distingué plus tard entre les consortiums rigides et les consortiums souples: les consortiums rigides sont ceux ayant des objectifs à long terme qui devraient opérer de manière permanente avec ou sans expansion de ses membres. Les consortiums souples, par opposition, sont ceux formés dans un but spécifique et qui sont dissolus une fois la tâche effectuée.
Il y a donc un type plus informel de coopération entre les entreprises. Également, certains consortiums souples peuvent évoluer vers des consortiums rigides, lorsque les membres perçoivent les bénéfices d’une approche collective et élargissent leurs objectifs et leurs engagements.
2.État des lieux des consortiums d’exportation
Les consortiums d’exportation ont connu une grande évolution depuis leur apparition tant à l’échelle internationale qu’à l’échelle nationale. Dans ce paragraphe, nous allons présenter l’état des lieux de ces consortiums d’exportation sur les deux échelles.
L’objectif de ce titre est de mettre l’accent sur les expériences de quelques pays européens, notamment la France et l’Italie, ayant réussi la mise en place des consortiums afin d’améliorer la compétitivité de leurs PME et tirer profit des opportunités offertes par la mondialisation et la globalisation des échanges.
2.1 L’expérience Italienne:
Cette expérience présente des enseignements de taille pour toutes les PME des pays en voie de développement. Rappelons tout d’abord que les PME/PMI occupent une place prépondérante dans l’économie de ce pays connue aussi par la prédominance des secteurs traditionnels notamment le textile, le travail du cuir, la céramique et la lunetterie[1].
L’économie italienne est connue aussi par ses anciens districts industriels ayant vu le jour depuis les années soixante. Ainsi, les premiers consortiums ont été fondés pendant cette période et le nombre de ces structures dépasse aujourd’hui 500 consortiums.
En 1974, ce pays a créé la fédération italienne des consortia d’exportation(Federexport) dont l’objectif principal est de défendre les intérêts des entreprises membres des consortiums.
En outre, les consortiums mono-sectoriels accaparent 60% des consortiums contre 40% plurisectoriels en Italie. En terme de vocation, nous trouvons la prédominance des consortiums de promotion avec une part de 90%. Ce chiffre montre l’importance accordée aux activités de promotion et de conquête des marchés étrangers.
Pour inciter les PME italiennes à bénéficier des différents avantages des consortiums d’exportation, les autorités de ce pays ont mis en place un arsenal juridique attrayant. En bref, ce pays a récolté les fruits de sa politique de renforcement des PME/PMI dans la mesure où la création et le développement des consortiums d’exportation ont contribué fortement à l’amélioration de la compétitivité des entreprises italiennes.
2.2 L’expérience Française:
L’expérience française est aussi riche en enseignements que celle de l’Italie sauf que la France n’a commencé la mise en place des consortiums d’exportation qu’à partir des années quatre vingt dix.
En 1996 précisément, un groupe de travail composé de spécialistes du développement endogène a tenu une réunion au commissariat du plan dont l’objectif principal est de tracer les politiques publiques spécifiques à mettre en place pour contribuer à la structuration et la pérennisation des systèmes productifs sur le territoire français.
Un système productif local peut être défini comme « une organisation productive particulière localisée sur un territoire correspondant généralement à un bassin d’emploi. Cette organisation fonctionne comme un réseau d’interdépendances constitué d’unités productives ayant des activités similaires ou complémentaires qui se divisent le travail(entreprise de production ou de services, centres de recherche, organisme de formation, centre de transfert et de veille technologique, etc.)
Actuellement, la France compte plus de 300 consortiums à l’exportation fédérant plus de 5000 PME opérant dans plusieurs secteurs d’activité notamment l’agroalimentaire, l’artisanat et les nouvelles technologies.
Conclusion:
Tout au long de cette publication, nous avons présenté quelques généralités sur les consortiums à l’exportation, notamment les définitions données par les auteurs à ce concept, raisons d’être liées principalement aux difficultés rencontrées par les PME, la typologie des consortiums, les avantages procurés par ces structures communes ainsi que l’état des lieux des consortiums d’exportation aussi bien au niveau mondial qu’au niveau national.
Certes, convaincre un certain nombre de PME de la pertinence d’un consortium d’exportation n’est pas une tâche aisée, mais le plus difficile est d’assurer la pérennité et surtout la performance d’une telle structure.
Sources et références:
- Paulette Pommier, (2004), « Système productifs locaux et pôles de compétitivité »
- « Les systèmes productifs locaux », (2002), DIACT, la documentation française, Paris
- Guide ONUDI et Federexport.